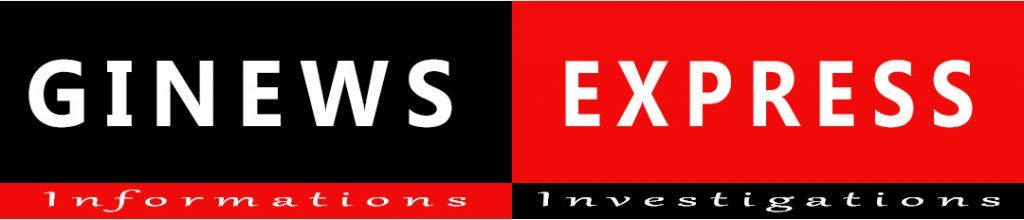L’amphithéâtre est plein. Silencieux. Suspendu aux mots du professeur Guy Rossatanga-Rignault. Ce 15 juillet 2025, à l’EM-Gabon, le droit international devient spectacle d’intelligence et de rigueur. L’homme sait captiver. Il tranche, explique, éclaire. Avec une voix posée et une pensée acérée.
Le thème est dense, le règlement judiciaire des différends internationaux. Un sujet aride ? Pas sous sa plume orale. Rossatanga-Rignault déroule les faits, les contextes, les subtilités. Il mêle l’histoire, le droit, la géopolitique. Et bouscule les idées reçues.
Premier cas évoqué, le litige frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. L’affaire Bakassi. Le professeur rappelle que la Cour internationale de justice (CIJ) ne s’autosaisit jamais. Ce sont les États qui l’y autorisent. Consentement indispensable, mais souvent difficile.
En 2002, la CIJ donne raison au Cameroun. Mais il faudra encore quatre ans et l’accord de Greentree pour que le Nigeria plie. Le droit avait parlé, mais la politique devait suivre. Rossatanga-Rignault le martèle : “L’uti possidetis juris n’est pas une invention africaine. C’est un legs latino-américain.” Comprendre que le droit postcolonial dépasse les frontières du continent.
Puis vient le dossier sensible du Gabon contre la Guinée équatoriale. Un vieux différend. Trois îlots; Mbanié, Cocotiers, Conga. Et une querelle d’un demi-siècle.
Le Gabon s’appuie sur la Convention de Bata de 1974. Selon Libreville, elle consacre sa souveraineté. Malheureusement, la Guinée équatoriale nie son existence. Et la CIJ choisit une autre voie.
La décision s’ancre dans un document oublié, la convention franco-espagnole de 1900. Le Résultat est là, les terres continentales vont au Gabon, mais les îles à la Guinée équatoriale. L’effet est paradoxal. La loi coloniale l’emporte sur les engagements post-indépendance. Le professeur s’interroge, “Décision juridiquement solide, mais historiquement bancale.”
La CIJ a tranché. Mais elle n’a pas tout réglé. La frontière maritime reste floue. Le terrain est ouvert à la négociation. Aux diplomates de jouer. “Le droit ne dit pas tout”, glisse Rossatanga-Rignault. “L’histoire et la mémoire comptent aussi.”
Il appelle à la responsabilité. Au calme. À la sagesse. À l’africanité. Celle qui fait primer la paix sur le contentieux. “Les cartes sont entre les mains des États”, conclut-il. “Ils peuvent encore réinventer la frontière.”
Un ton grave. Un message clair. Une leçon de droit, mais aussi de lucidité. À l’EM-Gabon, le professeur n’a pas simplement parlé. Il a réveillé les consciences.
Ethan De Sillon