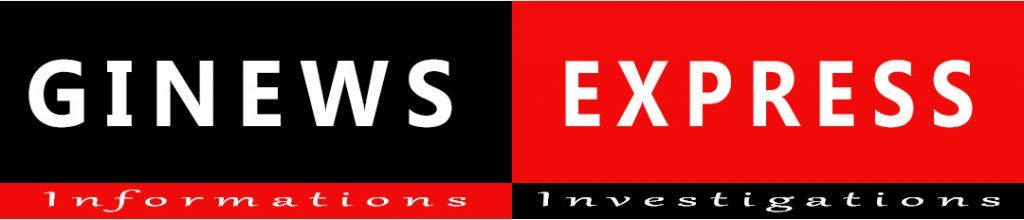Il arrive aux institutions de s’user avant même que leurs murs ne se fissurent. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG) semble aujourd’hui confronté à cette forme d’érosion lente, presque imperceptible, jusqu’au moment où la contestation cesse de murmurer et choisit la lumière.
La charge portée contre Abdur-Razzaq Guy Kambogo et son équipe ne surgit pas du néant. Elle est l’aboutissement d’un processus. Une accumulation de silences, de décisions contestées, de mécanismes grippés. En somme, une crise moins spectaculaire que structurelle.
Toute autorité religieuse repose sur un équilibre délicat, la compétence, la légitimité morale et l’adhésion collective. Lorsque l’un de ces piliers vacille, l’ensemble devient instable.
Depuis 2024, le CSAIG est perçu par une partie de la communauté comme une institution en décalage avec sa mission première. Non par excès de décisions, mais par défaut de cap. L’absence de vision clairement formulée agit comme un vide, et le vide appelle toujours des conflits. Dans cet espace laissé vacant, les soupçons prospèrent. Non parce qu’ils sont toujours fondés, mais parce qu’aucun cadre transparent ne vient les dissiper.
Les accusations de modification contestée de la charte, de non-application des résolutions congressistes ou de gestion opaque de dossiers sensibles traduisent un même malaise, la norme n’est plus lisible. Or, dans une institution religieuse, la règle ne vaut pas seulement pour son contenu, mais pour ce qu’elle symbolise. Elle incarne l’équité. Lorsqu’elle semble flexible selon les circonstances ou les acteurs, elle cesse d’unifier.
La question du pèlerinage illustre ce glissement. Ce qui devrait être un acte spirituel collectif devient un point de tension administrative, voire financière. À ce stade, ce n’est plus seulement une gestion qui est mise en cause, mais la capacité de l’institution à préserver le sacré de l’utilitaire.
Les tensions observées dans plusieurs mosquées ne sont pas des incidents isolés. Elles fonctionnent comme des révélateurs. La mosquée, espace de prière et de régulation sociale, devient le lieu où se projettent les dysfonctionnements du sommet. Les nominations contestées, les affrontements verbaux ou physiques, traduisent une perte de confiance dans l’arbitrage central.
Lorsque l’autorité religieuse ne parvient plus à pacifier, elle est perçue comme partie prenante du conflit. À partir de là, chaque décision est suspecte, chaque silence interprété.
Toute crise institutionnelle finit par se cristalliser autour de figures humaines. Le cas de certains responsables accusés d’irrégularités, mais maintenus dans l’appareil, cristallise un sentiment largement partagé, celui d’une dissociation entre discours moral et pratiques internes. Ce décalage n’est pas seulement administratif. Il est symbolique. Il fragilise l’institution plus sûrement que n’importe quelle attaque extérieure.
Le CSAIG ne vit pas hors sol. Subventionné par l’État, il évolue dans un champ où le religieux et le politique se frôlent sans jamais se confondre totalement.
Dans un contexte de transition nationale, cette proximité devient plus visible, donc plus sensible. Chaque geste est lu à travers le prisme du soupçon, stratégie de survie pour les uns, alignement pour les autres.
Le discours sur l’unité, pourtant central dans toute tradition religieuse, perd alors de sa force. Non parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il intervient tard, lorsque la fracture est déjà apparente.
L’islam gabonais d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Plus nombreux, plus divers, plus connectés, les fidèles attendent désormais des institutions qu’elles soient à la fois spirituelles et rigoureuses dans leur gestion.
Face à cette évolution, le CSAIG donne l’image d’une structure qui peine à se réinventer. Ce décalage temporel alimente l’incompréhension. Et l’incompréhension, lorsqu’elle dure, se transforme en rupture.
Le boycott, les appels à la refondation, les mises à distance institutionnelles traduisent une perte de confiance avancée. Mais ils posent aussi une question fondamentale, que se passe-t-il lorsque l’autorité centrale se fragilise sans alternative clairement structurée ?
L’histoire récente, ailleurs comme ici, montre que le vide institutionnel est rarement neutre. Il est souvent occupé par des acteurs moins régulés, parfois plus radicaux, toujours plus difficiles à encadrer.
La crise du CSAIG n’est donc ni anecdotique ni purement conjoncturelle. Elle constitue un moment charnière. Elle interroge la capacité de l’institution à se réformer, à clarifier ses règles, à restaurer la confiance sans céder à la personnalisation du conflit. Elle interroge aussi le rôle de l’État, garant indirect de la stabilité des cultes.
Au fond, la question n’est pas seulement de savoir qui dirige le CSAIG, mais comment il est dirigé, et au nom de quoi. Car dans toute communauté religieuse, lorsque l’éthique cesse d’être visible, l’autorité cesse d’être évidente.
Edouard Dure